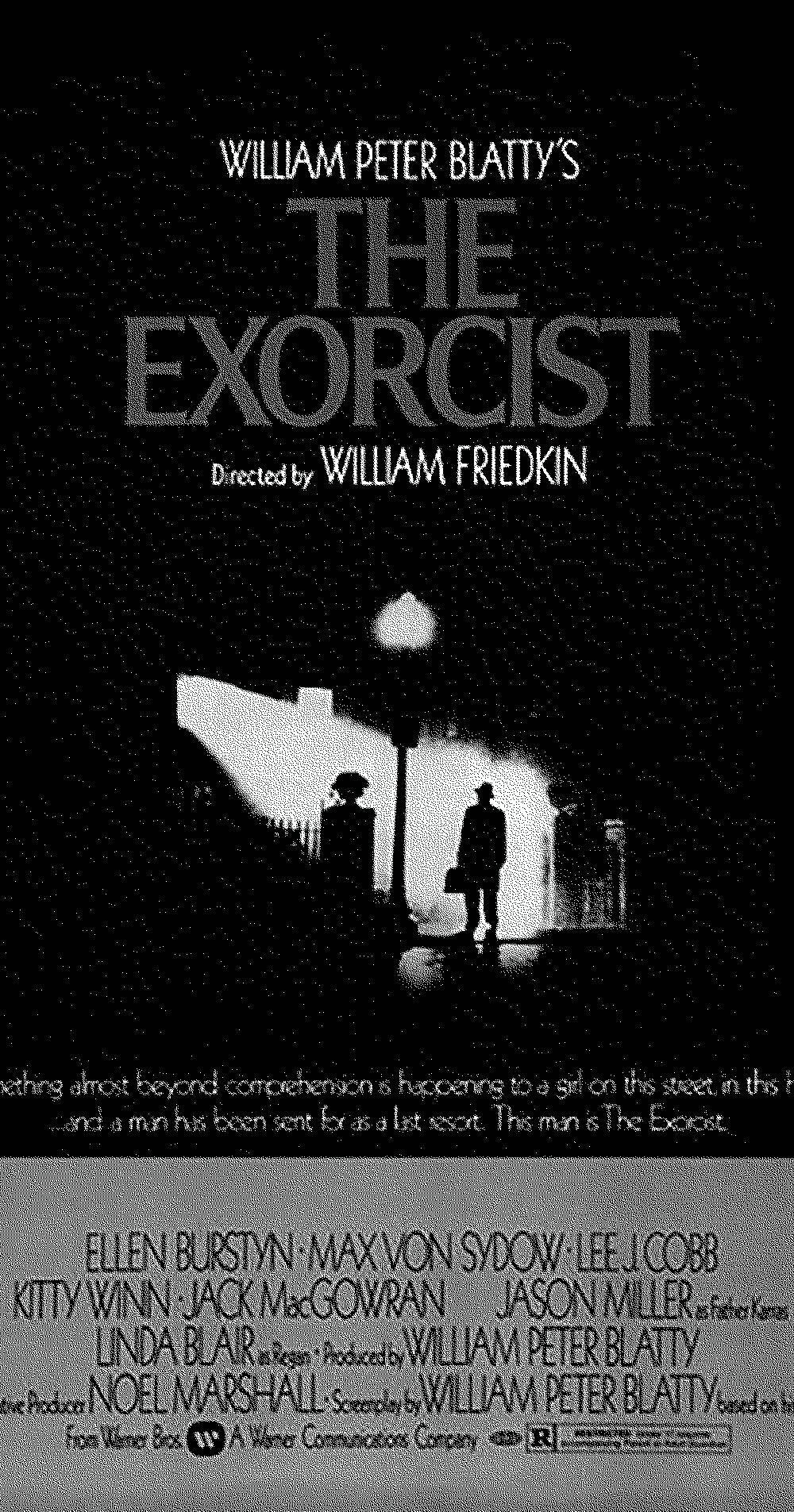II → Ⓒ
Sensibilités esthétiques et culturelles
img23 — Stephen Frankfurt, affiche américaine de Alien, réalisé par Ridley Scott, États-Unis, 1979
img24 — Artiste inconnu, affiche polonaise de Alien, réalisé par Ridley Scott, États-Unis, 1979
Certaines affiches spécifiques de films sont très prisées des collectionneurs. Soit parce qu’elles témoignent des évolutions parfois radicales du genre, soit par leurs tentatives de séduire un public différent.
« Ces images sont l’exact reflet des publicités et surtout des modes de leur époque, aussi bien du point de vue esthétique que graphique. Frankenstein de James Whale (1931) est représenté initialement dans un style très Art déco avant de se voir virer au gothique lors de sa reprise quelques années plus tard. Il est intéressant de voir le nombre de styles qui ont été utilisés pour les différents sorties de King Kong(1933) tout au long des décennies qui ont suivi sa sortie. De même, chaque pays produit son propre style publicitaire : le même film peut du coup avoir des affiches qui diffèrent radicalement en fonction des marchés ; ainsi les posters tchèques et polonais figurent parmi les plus élégants. »²⁶
²⁶Stephen Jones, L’Art des films d’horreur (The Art of Horror Movies: An Illustrated History), (2017) Gründ (Paris, France).
Quand il faut adapter une affiche pour un pays étranger, il faut appliquer bien plus qu’une simple stratégie marketing. Ni les couleurs, ni les symboles n’ont la même signification, car c’est la culture qui diffère. Tous les procédés et techniques cités auparavant, en grande partie à destination d’un public occidental, deviennent caduques pour le public asiatique par exemple. L’histoire du graphisme y est complètement différente, et ce n’est pas aux spectateurs de s’adapter. Il faut donc revoir sa copie et déconstruire tous les a priori que l’on avait jusque là.
Un des éléments à ne pas délaisser, c’est la couleur. Le cinéma d’exploitation en fait un usage particulier. Ses symboliques sont importantes, Michel Pastoureau²⁷ l’a démontré dans Le petit livre des couleurs. Petit florilège des interprétations qu’il en fait :
« Le bleu est une couleur bien sage, qui se fond dans le paysage, et ne veut pas se faire remarquer. […] il a su s’imposer, doucement, sans heurter… Le voilà désormais canonisé, plébiscité, officialisé. Devenu, en Occident, garant des conformismes. […] Le rouge, lui, est une couleur orgueilleuse, pétrie d’ambitions et assoiffée de pouvoir, une couleur qui veut se faire voir et qui est bien décidée à en imposer à toutes les autres. »
En parlant du blanc il ajoute :
« cette couleur-là est sans doute la plus ancienne, la plus fidèle, celle qui porte depuis toujours les symboles les plus forts, les plus universels, et qui nous parle de l’essentiel : la vie, la mort, et peut-être aussi — est-ce la raison pour laquelle nous lui en voulons tant ? — un peu de notre innocence perdue. […] Dans le petit monde des couleurs, le jaune est l’étranger, l’apatride, celui dont on se méfie et que l’on voue à l’infamie. Jaune comme les photos qui pâlissent, comme les feuilles qui meurent, comme les hommes qui trahissent… […] Désormais, l’élégance est en noir. Mais il y a plus encore : avec le blanc, son compère, le noir nous a construit un imaginaire à part, une représentation du monde véhiculée par la photo et le cinéma, parfois plus véridique que celle décrite par les couleurs. »
²⁷Michel Pastoureau est un historien, anthropologue, spécialiste des couleurs, des images et des symboles né en 1947. Sous la forme d’un entretien mené par Dominique Simonnet, Le petit livre des couleurs a d’abord été publié en feuilleton dans L’Express entre juillet et août 2004.
La couleur n’est qu’un facteur à prendre en compte parmi d’autres, tout comme la typographie ou encore la composition générale de l’image. C’est en observant deux affiches pour un seul et même film que l’on peut au mieux comprendre les différences fondamentales entre deux cultures.
Poltergeist est un film américain de Tobe Hooper²⁸, produit par Steven Spielberg, dont il se dit qu’il serait plus ou moins le véritable réalisateur du film. Sorti dans les cinémas américains en 1982, ce classique de l’épouvante est une histoire qui se repose sur un contexte familial confronté à des phénomènes paranormaux. Bénéficiant d’un budget relativement conséquent, le film avait donc toutes les cartes en main pour communiquer sérieusement, et ainsi s’assurer un certain succès.
²⁸Tobe Hooper (1943–2017) est un réalisateur américain, spécialiste du film d’horreur, à qui l’on doit le célèbre Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974
Return of the Living Dead, Beetlejuice et Poltergeist ont pour point commun d’avoir eu la chance d’être passé entre les mains de Carl Ramsey. Chacune de ses affiches est mémorable. C’est la période de la peinture à l’aérographe. Avec Drew Struzan, Ramsey en est l’un des principaux contributeurs. Les deux hommes se connaissaient, Struzan ayant même initié Ramsey à la technique.
Avant de travailler pour le cinéma, l’artiste américain réalisait des pochettes d’albums, notamment pour Alice Cooper, dont il a fait la célèbre cover de Cooper Billion Dollar Babies.
img25 — Carl Ramsey, affiche américaine de Poltergeist, réalisé par Tobe Hooper, États-Unis, 1982
Poltergeist doit beaucoup à son affiche (img25). Pourtant très simple, celle-ci se remarque immédiatement par son minimalisme. Elle met en scène le personnage de Carol, la petite fille du film, sur qui le spectateur s’investit le plus émotionnellement. Elle incarne l’innocence et la vulnérabilité face à la menace qui gronde. Cette menace ne sera pas illustrée, choix audacieux. Le clair-obscur ambiant de l’affiche, ajouté à la sensation de vide et d’isolement suffisent à déstabiliser le spectateur.
La typographie du titre semble elle aussi vouloir s’effacer le plus possible, et ne fait ressortir que les lignes claires de ses contours. L’accroche « they’re here », courte et efficace, triomphe au milieu du visuel.
img26 — Artiste inconnu, affiche japonaise de Poltergeist, réalisé par Tobe Hooper, États-Unis, 1982
L’affiche japonaise du même film(img26) fait des choix drastiquement différents. L’omniprésence du noir est conservée, mais doit cohabiter avec une effusion de couleurs, qui paraissent très inhabituelles au genre et éloignées du film initial. Le titre prend à lui seul un quart du visuel, et s’intercale entre une image aérienne de la ville du film et une forme abstraite symbolisant surement un esprit fantomatique. Tout en haut on retrouve une photo en couleur du personnage de Carol, qui n’a pas spécialement pour vocation l’identification du public.
Le cinéma fantastique et horrifique peut souvent compter sur ses effets pour communiquer. Lorsqu’un film de ce type est vendu, il se repose bien souvent sur sa créature ou son univers pour éveiller la curiosité. Mais en vérité, on remarque que deux méthodes répandues s’opposent. La première consiste majoritairement à faire appel au grotesque, déjà expliqué auparavant. La seconde joue sur une promesse, celle du mystère à révéler. Cette dernière a engendré quelques unes des affiches les plus célèbres du XXe siècle, de Alien à Rosemary’s Baby, que l’on doit notamment à Stephen Frankfurt.
Nos yeux, habitués à une surabondance de messages publicitaires, en viennent à s’arrêter sur un visuel qui ne correspond pas à cette norme. Plusieurs éléments en sont responsables. La composition, dans un premier temps : les choix typographiques, et la couleur. Lorsqu’un film est vendu à l’étranger, la logique commerciale veut qu’une affiche corresponde aux normes aux normes graphiques mais surtout sociétales et culturelles, aux traditions du pays en question. Cela peut aller vers des différences drastiques en terme de style adopté, mais le plus souvent les modifications sont plus subtiles que ça.
Outre les choix typographiques qui peuvent être faits (majoritairement liés à la langue), c’est surtout les différences de gammes chromatiques choisies qui interpellent.
« Premier constat : Les couleurs sont des idées qui évoluent en fonction du temps et de l’espace. Le rouge par exemple n’évoque pas les mêmes choses dans l’antiquité qu’au Moyen âge, et au XXIe siècle il est perçu différemment en France et au Japon. […]
Le bleu est la couleur préférée des occidentaux. Mais attention, le bleu revient de loin. Après avoir été dévalorisé et vulgaire pendant l’antiquité, il devient successivement la couleur de Dieu, de l’honnête chrétien, des rois de France, des romantiques, évoquant le rêve, l’infini, la mélancolie (le blues). D’abord une couleur féminine puis une couleur masculine, une couleur chaude puis une couleur froide (et même très froide, plus froide que le vert et le blanc, en attestent les boites de Tic-tac). Autrement dit, après avoir été à peu près tout et n’importe quoi, le bleu devient finalement au XXe siècle en Occident la couleur la plus consensuelle, la plus neutre, la moins agressive, celle des organismes internationaux (UE, ONU, UNESCO). Si bien que dire qu’on aime le bleu aujourd’hui ne dit plus rien de notre personnalité. »²⁹
²⁹Cannelle Favier. (novembre 2015). Les affiches de films occidentaux en Asie. Cinepsis.
Poltergeist, pour son affiche américaine, fait le choix du noir et blanc. Le noir est omniprésent et envahit l’image, qui devient au trois-quart bouchée par cette couleur. Énorme prise de risque lorsqu’on prend en compte la symbolique des couleurs. D’autant plus que le public américain est habitué à un usage peu modéré de la couleur. Mais le noir est blanc reste pourtant l’opposition chromatique par excellence dans la culture occidentale ; directement liée aux significations du fantomatique, de la mort et de l’étrange. L’affiche américaine compte donc sur l’interprétation innée que le public fait d’une couleur pour marquer les esprits.
Mais que se passe-t-il si ces codes sont chamboulés ? Et c’est le cas ici, dans le cadre de la communication nippone du film. Car dans la culture asiatique, le noir ne s’oppose pas au blanc, son contraire est le rouge. Ajouté à cela que le concept de la mort diffère complètement, il devient difficile pour un graphiste occidental de créer une image qui soit tout aussi compréhensible. Une histoire de fantôme n’évoque pas les mêmes peurs d’un pays à l’autre.
Pour l’affiche japonaise, la figure du spectre, du fantôme, devient une tâche colorée qui prend possession de l’affiche, tandis que la figure humaine omniprésente du côté américaine se retrouve au second plan, tout en haut du visuel. Il aurait été inimaginable en Occident de symboliser une figure fantomatique avec un emploi aussi extrême de la couleur.
La composition quasi abstraite du visuel, certes surprenante, répond cependant à une certaine tradition du graphisme nippon.
« Ces œuvres possèdent une esthétique visuelle inhabituelle qui captive totalement, et semble pourtant réfuter toutes les règles conventionnelles de la communication visuelle… Ce qui est annoncé est souvent peu clair, et l’affiche japonaise tend à être considérée comme une incarnation visuelle des idées philosophiques d’Extrême-Orient. »³⁰
³⁰Citation de Bettina Richter. Rachael Steven. (février 2014). A history of Japanese poster art. Creative Review.
Le concept graphique exploité par l’affiche américaine n’est pourtant pas moins intéressant. Avec le personnage de l’enfant scotché à l’écran, il fait référence à une génération bercée par la télévision. Mais il confronte surtout le spectateur à ses angoisses et l’invite directement à s’impliquer émotionnellement dans le film. C’est une forme de mise en abîme cinématographique.
Le traumatisme nucléaire est très ancré dans la culture nippone. La création de Godzilla est une allégorie qui y fait clairement référence, et il n’est pas rare de recroiser l’exploitation de certains de ces symboles dans la culture populaire. La figure du fantôme, moins terrifiante pour le spectateur nippon, serait alors délaissée au profit d’une image abstraite qui évoque un traumatisme plus inconscient.
Le cinéma d’exploitation entretient un rapport sensible vis-à-vis de l’appropriation culturelle. Car ses artistes savent mieux que quiconque ce qu’il représente pour ceux qui l’aiment vraiment. Les maladresses, même si inhérentes au genre, sont à proscrire. D’où cette particularité d’adapter correctement des affiches pour un public aussi varié, composé d’autant de sensibilités que de sous-genres rattachés. •